La presse du jeu vidéo est en crise. Pour les journalistes du secteur, ce n’est pas une nouvelle : entre les semaines à rallonge, les heures supp non comptabilisées, les burn out, les départs des collègues de longue date, la raréfaction des postes et la précarité de la profession, les perspectives d’avenir et de prospérité sont minces.
Le journalisme du jeu vidéo n’est qu’un des révélateurs de l’étau dans lequel est comprimée la presse numérique depuis des années.
Pour les consommateurs et les consommatrices de contenus, rien n’a vraiment changé. L’accès aux tests, soluces, articles de news est toujours gratuit, et les influenceurs ont commencé eux aussi à se tailler la part du lion de ces vues « faciles ». En imposant au passage une nouvelle concurrence aux médias qui peinent déjà à survivre.
Le statu quo ne risque pas de changer.
Cette tendance, loin de faiblir, n’est annonciatrice que de mauvaises nouvelles pour les rédacteur·trices, les journalistes et la presse du jeu vidéo.
J’ai rencontré plusieurs journalistes et rédacteurs en chef pour comprendre et rendre compte des réalités vécues dans les rédactions généralistes et spécialisées qui traitent le jeu vidéo et l’esport.
Aux origines des maux : un business model axé sur la gratuité des contenus
Si l’on met de côté des médias comme Canard PC ou JV Le Mag, qui sont essentiellement connus pour leur format papier, la presse vidéoludique numérique s’est attachée à rendre son information entièrement accessible. Gratuite.
Vous êtes bloqué·es sur un jeu ou vous voulez connaître les avis sur le dernier triple A ? L’info est accessible en un clic sur Google. Les sites spécialisés se livrent une concurrence féroce pour être les premiers sur le mot-clé que vous avez tapé. Pour que vous cliquiez dessus, pour engranger des vues et si possible de l’argent grâce aux publicités.
C’est 95% du fonctionnement de la presse du jeu vidéo et de l’esport aujourd’hui. Si tout est gratuit, comment un média qui traite du jeu vidéo arrive aujourd’hui à dégager de l’argent ?
Pour Clémence Duneau, journaliste esport chez VICE, « la raison pour laquelle la presse est mal en point, c’est qu’on est parti du principe que l’information ne se paie plus, ce qui est totalement faux. On se repose sur la pub, mais la pub se casse la gueule. Ce modèle économique fonctionne de moins en moins, et donne l’impression à tout le monde que l’information est gratuite. »
On enfonce des portes ouvertes, mais la presse numérique a fait le pari de monétiser ses contenus en nouant des partenariats avec des régies publicitaires, qui permettent de rémunérer le média avec les fameux CPC et/ou CPM (coût par clic et coût moyen pour mille impressions).
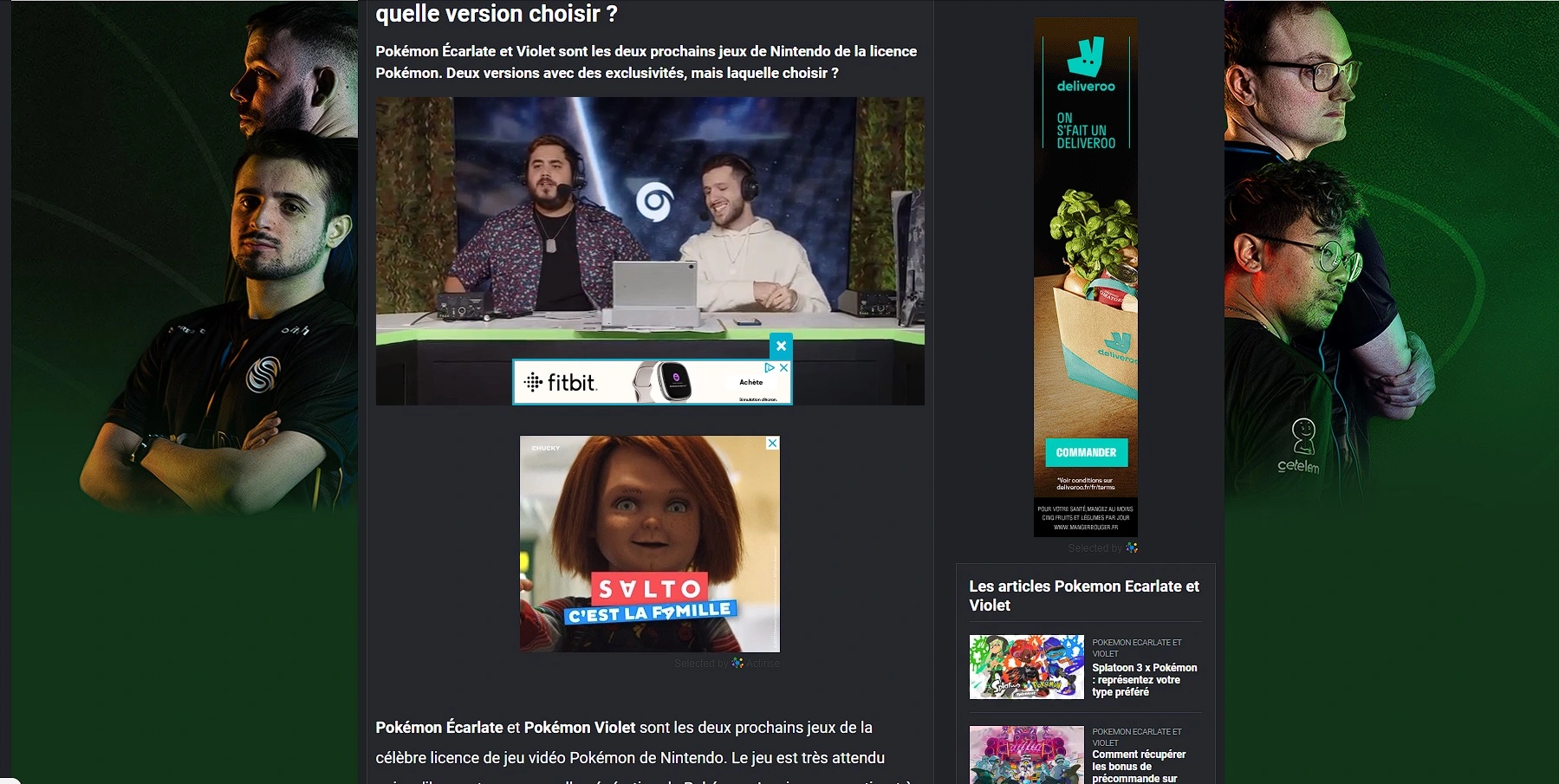
Un exemple de pubs, sans adblock, sur le site de Breakflip
Par exemple, adsense, la régie publicitaire de Google promet aux alentours de 48 000 dollars de revenus si votre site atteint le million de pages vues par mois. Cette estimation dépend évidemment de nombreux facteurs : la demande des annonceurs, l’appareil utilisé par l’utilisateur, le secteur d’activité, la taille de l’annonce etc.
C’est aujourd’hui le nerf de la guerre pour de nombreux sites internet. Pour ne pas mettre tous leurs oeufs dans le même panier, et rester complètement dépendants des publicités, les médias peuvent aussi travailler en marque blanche avec des entreprises (comprendre se faire payer pour créer du contenu pour la marque sans que votre nom n’apparaisse).
Dans le jeu vidéo, à contrario de ce qu’on peut observer pour la presse généraliste, rares sont les médias à proposer aux lecteur·trices de s’abonner pour accéder à leurs contenus. Historiquement, c’est Gamekult qui est en France le fer de lance de l’abonnement et de l’accès premium aux articles.
Le business model d’une presse qui compte quasi exclusivement sur ses revenus publicitaires a des impacts sérieux sur son business model, sa ligne éditoriale et sa stratégie d’action.
L’objectif est clair, pour maximiser ses profits, il faut faire du clic. En 2017 déjà, Le Monde Diplomatique publiait un article intitulé De l’information au piège à clic qui dénonçait les travers de Melty et Konbini. La course aux clics, la précarité des salarié·es, l’optimisation à l’excès du référencement, les contenus sponsorisés…
Aujourd’hui, la course aux clics est devenue la règle pour énormément de sites.
Dans la presse du jeu vidéo, Google, la pub et le SEO sont ROIs
C’est Google qui fait la loi. Le référencement naturel (ou SEO pour search engine optimization) est le moyen privilégié pour un média de s’assurer une visibilité sur internet.
Pour apparaître sur la première page de Google, les sites de presse de jeux vidéo se livrent une guerre sans merci. L’objectif affiché est d’être toujours devant la concurrence, afin que les lecteur·trices cliquent sur votre site, et pas celui d’un autre.
Plus vous aurez de trafic, plus il y aura de visibilité voire de clics sur les pubs, plus le site gagnera de l’argent, plus il sera en mesure de payer ses salariés, d’embaucher, de parfaire sa stratégie etc.
Ces contenus sont rapides à produire, et promettent aux rédactions des chiffres incroyables pour un coût ridicule. Des exemples, il y en a plein : la boutique de Fortnite, les codes pour Coinmaster, les soluces de jeux mobiles etc.
Un eldorado à portée de main, si puissant que même les rédactions dont ce n’est pas la ligne éditoriale s’y mettent. aAa en est un très bon exemple.
L’avantage de ces nouveaux contenus qui font grimper le référencement, c’est qu’ils ne nécessitent pas d’expertise ou de compétence particulière. Tout le monde peut s’improviser rédacteur, et être payé en freelance, voire pour les plus chanceux en CDD ou en CDI, pour produire ce genre de contenus.
Un CDI dans la presse du jeu vidéo reste une espèce de sésame auquel on se raccroche. On accepte de faire tout un tas de concessions.
On reproduit les travers du travail à la chaîne, où on demande à des jeunes passionné·es d’écrire parfois 10 articles par jour. C’est l’usine 2.0.
Et la question revient à chaque détour de conversation. Pourquoi payer un journaliste pour faire du contenu de fond, quand vous pouvez payer un freelance moins cher, pour du contenu seo-friendly, qui vous rapportera bien plus grâce à la pub ?
Le travail de fond, d’enquête, qui est propre au travail du journaliste, en devient secondaire. Et comment en vouloir à la presse du jeu vidéo, qui joue bon an mal an avec les règles du jeu qu’on lui impose ?
Pour Breakflip, initialement créé pour travailler sur l’esport, leur passion, le changement a été radical. Thomas Renaud, son président, m’explique qu’ « A la base on voulait faire de l’esport parce que c’était ce qui nous faisait kiffer. On s’est vite rendu compte que pour avoir un média pérenne, ce n’était pas une ligne éditoriale viable. Globalement, la majorité du public ne lit pas de l’esport mais le consomme via O’gaming, OTP, Solary, Kameto…. Ils vont consulter certains médias mais ça n’apporte pas un trafic rentable si tu veux payer des gens à temps plein. »
Aujourd’hui, l’esport ne constitue plus que 5% du trafic de Breakflip.
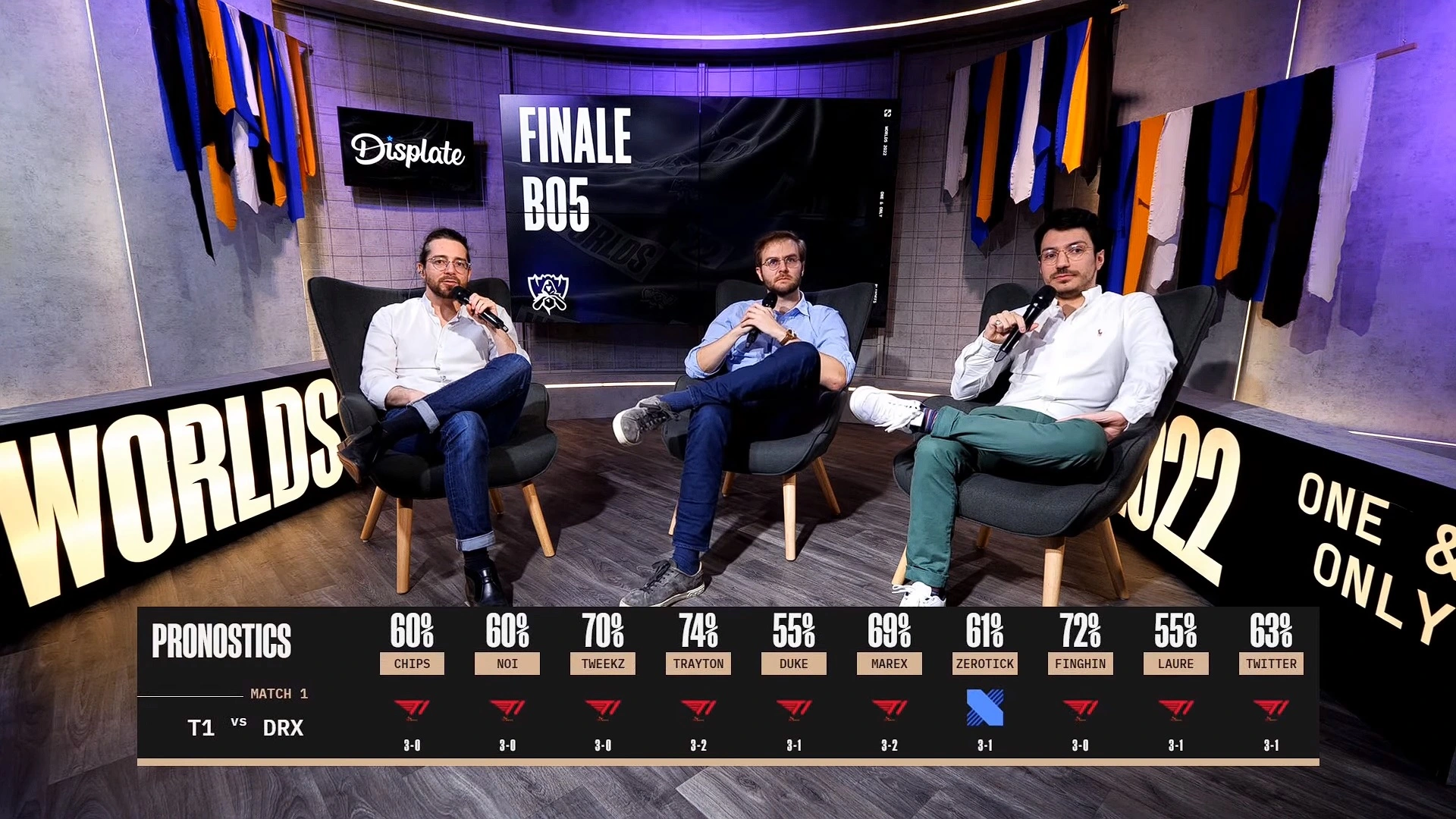
Les fans d’esport consomment le medium aussi et surtout en vidéo
La presse numérique du jeu vidéo est essentiellement dépendante des pubs pour vivre. Pour Breakflip mais comme pour tous les médias qui basent leur model business sur la pub, adblock est un véritable calvaire. Une problématique que connaît bien Thomas qui estime qu’ « aujourd’hui, quand t’es un média gaming/tech, Adblock te fait perdre la moitié de ton chiffre d’affaires total. Tu as un vrai manque à gagner. »
La perte est d’autant plus importante que les emplacements pubs sont plus nombreux sur ordinateur, où les gens restent sur les pages plus longtemps. D’où les tentatives des médias, plus ou moins fructueuses, d’alerter leurs lecteur·trices sur les besoins de désactiver adblock. Mais la menace qui gronde, c’est l’arrivée d’adblock sur mobile. C’est un futur possible qui fait craindre à Thomas pour l’avenir du secteur des médias numériques : « Le jour où adblock sur mobile se démocratise, ce sera une vraie catastrophe industrielle pour tout le monde. Il faudra que l’univers médias digital se réinvente. »
Pression du chiffre et cadences infernales
Martin* (ndlr, son prénom a été modifié), journaliste jeu vidéo depuis 4 ans reste lucide vis-à-vis de la publicité. « L’intégralité de nos revenus est d’ordre publicitaire et mon salaire vient de là. J’en suis tributaire et lorsque j’écris des articles de fond, je sais pertinemment que ce n’est pas mon lectorat qui va me rémunérer. »
Cette tendance influence forcément les cadences de travail. Les journalistes, déjà tributaires des heures de sorties des infos, ne comptent pas ou plus forcément leurs heures.
Martin a observé ce phénomène depuis plusieurs années et en conclut que « les gens font beaucoup d’heures supp qui ne sont pas payées : elles le sont en heures de récupération, ce qui est une hérésie absolue. Tu peux atteindre parfois plusieurs jours de récup, mais ça n’arrange personne de les prendre parce que tu te retrouves en sous-effectif et ça fout tes collègues dans la merde. »
Cette réalité du terrain rappelle les mécanismes à l’œuvre dans les studios de développement de jeux vidéo. En période de crunch, il est mal vu de partir à l’heure, puisqu’on fait peser toute la charge de travail sur ses collègues. Par solidarité, tout le monde reste et fait des heures supp.
Du haut de ses 17 années de carrière, Pipomantis, ex-journaliste du jeu vidéo passé par Joystick, Canard PC et Gamekult, s’estime chanceux d’être passé par des rédactions qui n’imposent pas de pression du chiffre ou de SEO, même si « la question du chiffre est toujours centrale puisqu’elle garantit la survie d’une publication. »
Pour autant, sans que les rédactions lui « aient caché les périodes difficiles », il rejoint les propos de Martin et avertit que « la contrainte majeure quand on est rédacteur est surtout temporelle. Que ça soit pour un bouclage papier ou pour faire tenir le rythme d’une rédaction web, la deadline est toujours là. »
Vers une disparition des journalistes au profit du marketing
Il est impossible pour moi de ne pas parler de Reworld Media. Dans le champ médiatique, et plus particulièrement celui de la presse papier et numérique, c’est un nom qui évoque beaucoup d’appréhension et de crainte.
L’entité, créée par Pascal Chevalier et Gautier Normand, s’est imposée comme le premier groupe de presse magazine français en nombre de journaux détenus. Sous son égide, des médias comme Auto Moto, Grazia, Closer, Télé Star, Sciences et Vie, Eclypsia, et récemment Les Numériques et Gamekult.
Les pratiques et la stratégie du groupe ont été extrêmement documentées par nos confrères et consoeurs. Dans son article sur Arrêt sur Images, Justine Brabant parle d’eux comme le “cauchemar de l’avenir du journalisme ». Des faits étayés par d’autres rédactions, comme Libération ou encore Le Monde. Pour les journalistes qui ont rendu compte des méthodes du groupe et interrogé les personnes qui y avaient travaillés, leurs objectifs sont clairs : dénoyauter au maximum les journalistes des médias qu’ils rachètent pour les remplacer par des travailleur·euses précaires, non-journalistes, payé·es pour produire le maximum de contenus à bas coût en faisant fi de toute rigueur.
Ils détestent les journalistes parce que c’est quelqu’un qui va fouiller la merde […] S’ils peuvent s’en débarrasser et en avoir le moins possible, ce serait idéal pour eux.
Aujourd’hui, les yeux de la presse du jeu vidéo sont tournés vers Gamekult, acteur ultra légitime et encensé par ses pairs pour la qualité de ses contenus, et aujourd’hui seul média spécialisé sur le jeu vidéo proposant l’accès à ses contenus contre abonnement.
Leur rachat par Reworld fait craindre à la fois pour l’avenir de leurs journalistes de leur indépendance, et plus généralement pour la presse indépendante de qualité.
L'autorité de la concurrence a validé la semaine dernière le rachat de Unify (Marmiton, Les Numériques, @Gamekult …) par Reworld Media.
— Ivan Gaudé (@IvanLeFou) October 13, 2022
Prise en main effective par Reworld d'ici la fin du mois.
Fin d'une époque pour @Gamekult :https://t.co/2H2eZtpg5Yhttps://t.co/7WE8DhgOFC
Martin voit d’un très mauvais œil l’implantation de ces grands groupes et craint pour son travail. « J’ai vraiment cette sensation que mon métier est en danger. Les grands groupes comme Reworld qui rachètent tous les médias ne veulent pas de journalistes. Ils détestent les journalistes parce que c’est quelqu’un qui va fouiller la merde, qui va chercher à tout savoir, à tout comprendre, à tout examiner. S’ils peuvent s’en débarrasser et en avoir le moins possible, ce serait idéal pour eux. »
Même constat chez Pipomantis, passé par Canard PC où « c’était presque une tradition de faire des réunions de crise » et qui considère que « ça fait un petit bout de temps que les journalistes savent qu’ils sont une espèce menacée, et c’est effectivement des discussions au long cours qui embaument la plupart des salles de réunion de nombreuses rédactions. »
Si là encore, il s’estime chanceux d’être passé par des rédactions qui « aiment la presse et le journalisme et comprennent l’importance d’avoir des plumes expérimentées » il a observé « la violence de ce qui est en train de se jouer » et considère que « la concentration des médias par quelques grandes fortunes n’aidera pas la situation à s’améliorer. »
Invisibiliser les journalistes devient une tendance
Plus généralement, il y a aussi un risque d’invisibilisation des journalistes dans les rédactions.
Un phénomène qui s’explique par les départs des journalistes qui s’étaient fait un nom dans l’industrie, l’arrivée de nouveaux peu connus, les règles toujours actualisées du SEO où il faut faire toujours plus et plus vite, le travail à la chaîne, la précarisation des contrats etc.
Thomas se remémore son passage chez Millenium, puis Eclypsia : « Chez Eclypsia, avec Kwev et Kassor, les journalistes étaient un peu personnifiés : on les connaissait, ils passaient dans les émissions, il y avait une vraie relation entre les gens avec les rédacteurs. Tu vas connaître le journaliste et tu vas lire tous ses papiers. Chez Breakflip, on a décidé de ne pas avoir trop de personnalités qui sortent du lot, et de surfer plutôt sur ce qui va intéresser les gens. Mais c’est important la personnification, le fait que les gens te reconnaissent. C’est quelque chose qui nous manque. »
Les temps ont changé, depuis la belle époque d’Eclypsia, avec ses rédacteurs vedettes et ses streamers reconnus. Relancé en 2020 par la société LevelUp, Eclypsia a depuis été rachetée par Reworld Média – qui avait auparavant acquis meltygroup, incluant le site Supersoluce et La Crème du Gaming. La rédaction recherche avidement des contributeurs (un joli mot de la start-up nation pour dire bénévole).
Martin estime qu’ « il y a eu une relative anonymisation des journalistes chez nous : on est passé d’une équipe de journalistes connus à une équipe de rédacteurs avec beaucoup moins d’expérience. Ils sont tout aussi talentueux mais la marque ne met pas du tout en avant les gens qui écrivent. T’as l’impression que tout le monde est jetable et facilement remplaçable. »
Dans son cas, le récent regain d’intérêt pour la visibilité des journalistes de sa rédaction, à travers le concept d’EAT (“Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness”) n’est lié qu’à une stratégie SEO, donc de performances : « Les EAT, c’est un profil d’expert sur un sujet qui te sert de signature et qui est affiché dans tes articles. Alors que ça n’a jamais été un sujet, du jour au lendemain, c’est devenu important en termes de SEO ! Ça permet d’identifier l’auteur dans Google, ça nous personnifie un peu plus qu’avant mais on demeure assez invisibilisé. »
Le journalisme esport n’est pas épargné
Dans le milieu très fermé de l’esport, bénévoles, freelances, pigistes le savent mieux que quiconque. Le journalisme esportif est tout aussi voire moins bien loti que celui du jeu vidéo.
Encore plus niche, plus spécialisé, toujours en recherche d’une légitimité que le jeu vidéo “pur” a réussi à s’accaparer, le journalisme esportif est lui aussi en difficulté. L’esport n’étant qu’une petite partie du jeu vidéo, il fait aussi moins de vues, même si sa cote de popularité ne fait que croître (cf l’invitation récente de l’écosystème à l’Elysée que nous avions analysée dans notre article).
A l’international, les fermetures de médias et les licenciements se sont succédés ces derniers mois, laissant sur le carreau les journalistes qui avaient su se faire un nom dans le secteur.
En France, rares sont celles et ceux qui parviennent à vivre du journalisme esportif. On serait d’ailleurs tenté de parler de rédacteur·trices, d’intervieweur·euses voire de travail d’influence, tant le “vrai” travail de journaliste, ses valeurs et ses méthodes semblent peu mises en avant.
Chez les médias généralistes, c’est L’Equipe qui participe le plus à informer ses lecteur·rices sur l’esport, grâce à une couverture quotidienne de Paul Arrivé (autrefois pigiste, en CDI depuis 2019) et Corentin Parbaud (qui y pige 2 jours par semaine).
Pour Clémence Duneau, « l’esport n’est pas une priorité dans les rédactions généralistes, comparé à des thématiques comme la politique ou la société. Les rédactions estiment, à raison, que ça n’intéresse pas suffisamment le public généraliste pour avoir quelqu’un à plein temps dessus. »
VICE et L’Équipe laissent à leurs journalistes esportifs une grande liberté d’action. Si chez VICE, Clémence Duneau accorde beaucoup d’importance à traiter des grandes problématiques sociales et culturelles autour de l’esport, Paul insiste surtout sur les résultats. Ligne éditoriale oblige de L’Equipe, « l’esport est traité comme n’importe quel autre sport, donc on est obligé de traiter de la compétition : les résultats font que l’esport existe » explique Paul.
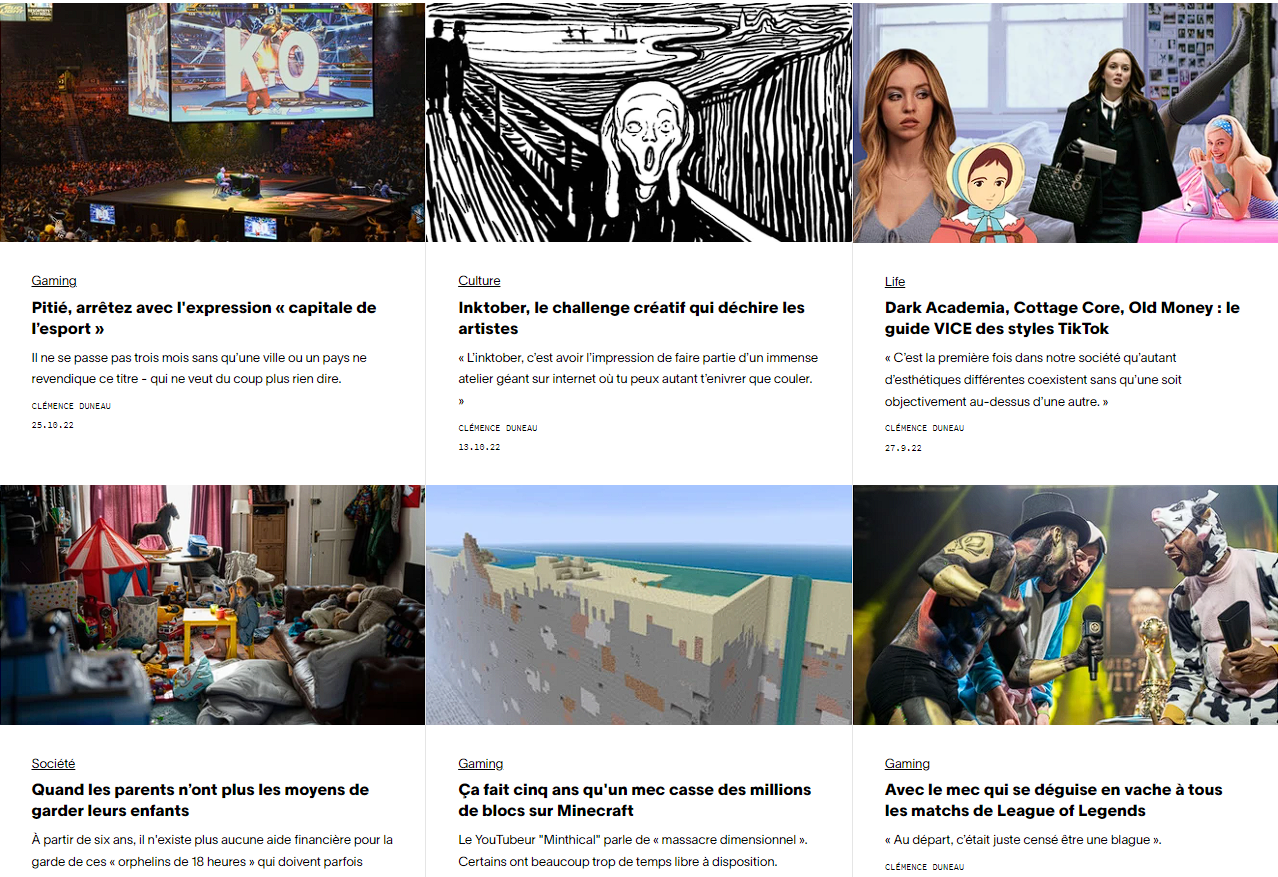
Chez VICE, Clémence Duneau ne travaille pas uniquement sur l’esport, mais touche à toute la culture web
Depuis plusieurs mois, Paul et Corentin se complètent pour livrer les meilleures informations esportives à leurs lecteur·trices. Mais les difficultés que rencontrent la presse du jeu vidéo créent une frustration chez les journalistes. D’autant plus que L’Equipe a subi un plan social en 2021. Paul reconnaît qu’il « a de la chance » d’être là et ne s’estime pas en danger. Pour autant, « c’est difficile de se dire qu’on va all-in sur l’esport dans ces conditions. » Paul avoue tout faire pour que Corentin soit titularisé, mais regrette « la lenteur des grosses machines comme L’Équipe » et craint de se retrouver une nouvelle fois seul pour gérer l’esport.
Il aimerait pouvoir travailler sur des sujets de fond et « creuser des sujets comme la santé mentale ou déconstruire le mythe du temps de réaction qui se perd avec l’âge. » Un travail qu’ils effectuent sur le temps long, lorsque les rythmes effrénés du LEC, de la LFL et de la scène CS:GO se terminent. Malgré le fait qu’il ait carte blanche, il ressent une frustration vis-à-vis de son travail. « On s’adresse aux gens de la mauvaise manière aujourd’hui, on devrait faire plus de vidéos, être plus présents sur Twitch pour faire des décryptages à l’oral avec des gens qui te posent des questions. C’est ce qu’on doit faire, mais on ne le fait pas. C’est une question de moyens mais surtout de réalisations et de consignes. »
Entre les « interviews de joueurs post-matchs assez redondantes » et les « vidéos full brandées d’influenceurs », Paul Douard, le rédacteur en chef de Vice en France, évoque sa frustration vis-à-vis du journalisme esportif. « Je ne voulais pas qu’on fasse ça chez VICE, il y a tellement mieux à faire : il faut montrer ce qu’il y a de bien, comme tout ce qui ne va pas dans le secteur. »
Fait important à noter, VICE n’est pas totalement tributaire de son audience pour (sur)vivre. Le média, international, compte moins sur la pub que sur ses partenariats en marque blanche, notamment pour la production vidéo. Un statut qui leur permet de « faire des paris » sans forcément se « mettre la pression. »
Dans le petit monde de l’information esportive, la majorité du travail est réalisée par des médias spécialisés : aAa, MGG, Dexerto, Breakflip… Bien que certaines rédactions aient décidé de recruter en CDD voire en CDI une majorité de leurs salarié·es, il reste que c’est souvent le freelancing qui prime, donc la précarité.
Même dans les médias généralistes, les journalistes spécialisés sur l’esport doivent passer par un long chemin de croix, entre périodes de piges et cumul de CDD.
Pour Clémence, qui a enchaîné plusieurs CDD avant d’être recrutée en CDI chez VICE, « la précarité du milieu va forcément avoir une influence sur la qualité du travail proposé. Ça laisse un vide dans le journalisme esportif : tu as assez peu d’articles de fond, peu d’enquêtes de qualité. Les pigistes obligés d’enchaîner cinq papiers dans la journée ne peuvent pas toujours te produire une super enquête ou un long reportage parce qu’ils n’ont simplement pas le temps ou bien qu’ils sont à bout. »
Un « journalisme » sous influence ?
Entre les joueurs propulsés aux rangs de stars, les salaires mirobolants, la popularité des créateur·rices de contenus, le fait de pouvoir vivre d’un métier-passion, l’esport fait rêver une majorité de jeunes.
Les journalistes et apprentis journalistes ne sont pas épargné·es par ces phénomènes. Clémence estime qu’il y a un « flou autour de ce que signifie être journaliste dans l’esport. Il y a des gens qui n’ont pas de formation, qui ne respectent pas une déontologie, ne recoupent pas leurs sources, acceptent des cadeaux dès qu’ils le peuvent. Je me demande si parfois le journalisme est perçu comme une façon de rentrer dans l’esport, avec l’idée que le plus important, c’est de faire partie du milieu et non pas le travail de journaliste. »
Se déclarer journaliste dans l’esport, c’est aussi une façon de se légitimer et de valoriser son travail. Pourquoi se décrire comme rédacteur, writer, alors que le terme de journaliste évoque plus de professionnalisme, de rigueur, d’honnêteté intellectuelle ? Ou permet simplement d’augmenter ses chances d’être invité·e à telle ou telle émission, sur tel ou tel stream. Bref, à gagner en notoriété et en popularité.
Ce qui appelle à d’autres questions : peut-on se déclarer journaliste lorsqu’une infime partie de notre travail correspond à cette définition ? Lorsqu’on accepte les partenariats et les cadeaux avec les marques ?
Paul Douard partage les analyses de Clémence et insiste sur la porosité de la frontière entre journalisme et influence. « Aujourd’hui, tu peux te présenter comme journaliste et faire du sponsoring pour Samsung. Les marques vont aligner les budgets à des gens qui ont acquis une grosse notoriété et glissent vers l’influence. »
Inquiet, il estime que « les médias ne pourront peut-être plus bosser sur l’esport, qui sera cloisonné par des éditeurs qui rinceront des semi journalistes-influenceurs » et qu’on arrivera à un statu quo où les gens « auront plus confiance en des gens payés par des marques qu’en des journalistes. »
Un journalisme parfois fait de concessions, de petits arrangements, de connivence. Un journalisme qui n’agit finalement plus comme un contre-pouvoir.
Pendant notre appel, Clémence insiste sur la rigueur de son métier : « le journaliste est censé garder une certaine distance avec ses sources. Le problème, c’est que dans l’esport, qui est un milieu très fermé, une des seules façons d’avoir des informations, c’est d’être invité aux soirées, aller prendre des verres avec les membres du milieu… bref de faire du copinage. Le problème c’est qu’une fois que ces gens-là sont tes potes, ça va complètement changer ton rapport à l’information. Devoir faire copain copain pour faire mon travail, ça me dérange. »
Préparer la suite pour la presse du jeu vidéo
Il n’y a ni recette miracle, ni formule magique pour inverser d’un claquement de doigt des années d’un modèle qui a prouvé son inefficacité.
Dans un monde parfait, on se plairait à décorréler les objectifs capitalistes et productivistes de la presse du jeu vidéo. La fin du rendement, de la pression du clic, pour les remplacer par le travail d’information ambitieux et rigoureux. En bref, redonner au journalisme du jeu vidéo et de l’esport ses lettres de noblesse. En faire un véritable outil de contre-pouvoir.
Le projet est ambitieux et n’est évidemment pas incompatible avec des mesures concrètes à court et moyen terme. Pour Martin, il faut commencer par « payer les gens correctement. C’est inacceptable que des gens avec 10-15 ans de métier soient payés 1600€ nets à Paris. Les conditions de travail doivent être améliorées et j’insiste sur ces questions d’heures supp non payées. Tant qu’il n’y aura pas vraiment de grosse grogne généralisée, ça continuera comme ça. »
Ce sont aussi les arguments avancés par Pipomantis, qui a quitté l’industrie à cause de « la non-valorisation de son travail et la violence d’une frange du lectorat » et qui y serait resté si les rédactions étaient « capables de payer correctement des profils de journalistes senior, ce qui n’existe presque pas dans la presse du jeu vidéo. »
On en est arrivé à un tel point de frustration et de détresse qu’aucun journaliste que j’ai interrogé ne conseille aux jeunes de devenir journaliste dans le jeu vidéo, ou en tout cas leur souhaite bien du courage. Même son de cloche pour Thomas Renaud, qui considère qu’il faut être « complètement frappadingue pour lancer un média aujourd’hui. »
Les départs des journalistes, leurs mises en garde et leurs critiques du modèle dominant de la presse n’y ont rien fait. La concurrence entre les rédactions, et par extension de leurs journalistes, n’arrange en rien les choses.
Pourtant, les solutions se trouvent peut-être dans les luttes collectives, que cela passe par le recours aux syndicats ou non.
Assumer de faire front, de se parler entre journalistes, et de se servir de la force collective pour contraindre les politiques à enclencher une vraie offre de service public pour le journalisme. Et soustraire une bonne fois pour toutes le journalisme des intérêts privés.
