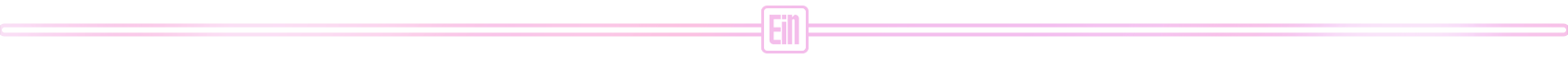S’il y a bien une chose que les différentes polémiques de ces dernières années nous ont appris, c’est que le jeu vidéo, comme n’importe quel secteur, n’est pas imperméable au racisme.
S’intéresser au racisme dans le jeu vidéo, c’est faire l’inventaire de ce que les catégories raciales et les histoires politiques, économiques et sociales ont produit comme inégalités, mais aussi passer à la loupe comment les stéréotypes produits se retrouvent de manière plus ou moins consciente dans la production vidéoludique.
Aujourd’hui, le racisme s’articule dans toute la chaîne de production des jeux vidéo. Des inégalités d’accès aux formations, à la difficile représentation des personnes racisées dans les studios de développement, de l’instauration de stéréotypes raciaux dans les jeux vidéo jusqu’aux inégalités d’accès aux matériels : on constate une plus grande représentation de personnes non-blanches sur les scènes consoles, alors que sur PC s’affichent majoritairement des personnes caucasiennes sur les scènes européennes.
Formaliser une historiographie exhaustive du racisme dans le jeu vidéo – il faudrait d’ailleurs parler des racismes – relève de l’impossible. Pourtant, on peut tenter d’en esquisser les contours, ou tout au moins de mettre en lumière ce que les impensés racistes ont pu avoir comme impact sur le jeu vidéo, et donc sur l’imaginaire collectif.
Pour répondre à ces interrogations, je suis parti à la rencontre de Mehdi Derfoufi, enseignant chercheur en études postcoloniales et études de genre, auteur en 2021 de l’ouvrage « Racisme et jeu vidéo ». Ensemble, nous avons tenté de lever le voile sur les réalités du racisme dans le jeu vidéo : un travail de vulgarisation à mon avis nécessaire pour comprendre ce qui se joue dans l’industrie vidéoludique et comment on peut rebattre les cartes pour y favoriser la diversité.
Qu’est-ce qui, dans ton parcours de vie et de chercheur, t’a amené à t’intéresser aux problématiques du racisme dans le jeu vidéo ?
Ce n’est pas forcément un objet d’étude dont je me suis emparé à proprement parler, mais c’est plutôt qu’étant arrivé en France à l’âge de 9 ans, en provenance du Maroc, j’ai été confronté assez vite à des situations de racisme. C’était en plus dans les années 80, juste avant le retour de la droite au pouvoir avec Charles Pasqua. Et puis les discours qui ont suivi sur le bruit et l’odeur, l’instauration d’un visa, les contrôles policiers, Malik Oussekine, 35 députés Front National à l’Assemblée Nationale… C’était une époque où j’ai vécu en plus en milieu rural en Picardie, dans une situation où je me sentais… particulier. Même si je bénéficie d’un white passing qui m’a pas mal aidé, il y avait toujours des situations où j’étais confronté au racisme, même si ce n’est pas en Picardie que c’était le plus fort. Ça a d’abord été ça.
Puis il y a le rapport entre ma mère française, mon père marocain et le rapport entre l’histoire coloniale entre les deux pays. C’étaient des choses qui étaient présentes avant même que ça devienne un sujet intellectuel.
Forcément, ça a toujours traversé toutes mes études, toutes mes lectures et ça a toujours été un sujet pour moi parce que ça concernait mon existence même.
Écrire un livre sur le racisme dans le jeu vidéo pose aussi la question du militantisme du monde académique. Est-ce que c’est lié à ton histoire de vie, le fait d’écrire de manière “militante” ?
J’ai eu une carrière avant l’université. L’université a toujours été présente en même temps que le reste de ma carrière (dans l’action culturelle et l’éducation populaire). L’intérêt que j’ai à travailler, à faire un travail quel qu’il soit, réside d’abord dans ce que je pense être son utilité sociale, publique, politique. C’est parce que j’ai l’impression que ça sert à quelque chose et qu’il y a un sens, que j’ai envie de le faire. Cette nécessité d’avoir un sens a toujours été là, et évidemment, dans la société dans laquelle on vit, ce sens je le trouve dans la lutte contre les inégalités et les discriminations.
Et puis, par rapport à l’université, disons qu’il y a dans le contexte français une sorte de réticence structurelle et historique. Elle a été bousculée par mai 68 qui est passé par là pour dire qu’il fallait un autre modèle de l’intellectuel et du chercheur. Mais l’académie a beaucoup résisté en disant “ce n’est pas de la science, c’est de la militance !”
C’est un discours qu’on continue de trouver, mais pour moi, m’engager à l‘université n’avait de sens que si je continuais à porter ce que je faisais ailleurs. Si on est républicain, qu’on veut défendre la liberté, l’égalité et la fraternité – ce en quoi je crois – je pense qu’une des missions de la recherche, c’est d’incarner ces notions et valeurs-là. Nécessairement, si on commence à se dire que la recherche doit se préoccuper des enjeux de liberté, d’égalité et de fraternité, forcément on s’engage sur des questions sociales et politiques. On ne peut pas rester en dehors. Ou alors, comme on le sait bien, lorsqu’on prétend rester en dehors, en réalité on fait le jeu du pouvoir, c’est-à-dire de l’hégémonie qui se présente comme objective, comme neutre, comme relevant du bons sens, de la raison.
Quand j’ai voulu me tourner vers l’université pour en faire un métier, évidemment, tu rencontres des difficultés. J’arrive avec plusieurs handicaps : mon inscription ethnoraciale, parce qu’on est toujours soupçonné de quelque chose surtout quand on assume certaines positions, et mon parcours atypique. Quand j’obtiens un poste à l’université en 2020, j’ai 45 ans. C’est tardif. J’ai passé ma thèse en 2012, j’ai commencé à faire des candidatures en 2013. En huit ans de candidatures, je n’ai jamais eu d’auditions en France, jamais. La seule année où j’ai eu deux auditions, c’est 2020. J’ai été finalement pris à Paris VIII.
Dans le même temps, je faisais des candidatures à l’étranger, aux Etats-Unis, en Suisse, au Canada, en Australie, et à chaque fois, j’avais des entretiens, voire j’étais classé. Ces auditions à l’étranger m’ont permis de garder confiance. J’y trouvais une écoute attentive et un intérêt pour mon travail et mes approches (postcoloniale et genre), mais aussi pour mon parcours atypique en dehors de l’académie et la personne que je suis.
En France, pour que ce soit pris au sérieux, on a l’impression qu’il faut que ce soit confisqué par des Gérard Noiriel ou des Stéphane Beaud. Quand des personnes prétendent s’en emparer et qu’elles sont racisées, d’un seul coup, ça devient du militantisme et on les prend moins au sérieux.
Je savais que ça allait être difficile, voire impossible en France, mais ça s’est fait. Je ne voulais pas renoncer parce que la vie m’avait déjà contraint à quitter une fois un de mes deux pays, et je ne vivais pas forcément très bien l’idée de ne pas être accepté ici et de devoir partir de nouveau. Mais c’était parti pour ne pas se faire et je n’aurais pas été le seul. La question de la scientificité et du militantisme, on voit qu’elle sert en réalité aussi à écarter des postes certains groupes sociaux et les minorités en général.
Les minorités qui s’occupent des problèmes qui concernent la minorité à laquelle elles appartiennent sont considérées comme militantes, et pas comme scientifiques. D’ailleurs, il faudrait des fois redéfinir ce qu’on entend par « scientifique ». Et avoir un peu de modestie, ne pas oublier que ce qu’on appelle “la science” n’est pas le seul mode de connaissance et de compréhension du monde.
Ce sont les minorités qui portent en majorité ces enjeux-là. C’est aussi parce qu’on est confronté au racisme, au sexisme, etc qu’on se dit que c’est un sujet et qu’il faut faire de la recherche là-dessus.
Ça reste confisqué par le groupe majoritaire au détriment des minorités parce qu’on va les soupçonner de ne plus être objectives. Chose d’ailleurs que j’assume parfaitement, je ne cherche pas à être objectif. Mais je cherche à ce que la recherche et l’enseignement servent à changer la société, dans le sens des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui sont censées être au fondement de la société. C’est de la recherche fondamentale et appliquée en même temps.
Le concept de race a été réinvesti pour expliquer et analyser les différences de traitement des personnes racisées. Est-ce que tu peux expliquer en quoi c’est pertinent pour produire des analyses antiracistes dans le jeu vidéo ?
Le jeu vidéo est un site de reproductions sociales comme un autre. Il est traversé par les expériences, les représentations, qui existent “ailleurs”.
Les individus qui jouent aux jeux vidéo restent les mêmes en arrêtant de jouer aux jeux vidéo. Ils vont aussi au cinéma, au bar, à la plage, ont des familles, meurent à l’hôpital, font leurs courses au supermarché… Bref, ils sont dans un continuum et pas dans une réalité autonome isolée du reste du monde. Il faut des mots pour penser la réalité des rapports sociaux. A partir du moment où des gens subissent du racisme, c’est parce que ces personnes-là sont inscrites à leur corps défendant dans des catégories qu’on appelle des catégories raciales. C’est vrai pour d’autres choses : catégories de classe, de genre etc. On va les enfermer dans des catégories raciales qui vont servir à les définir et à faire des individus des représentants “homogènes” de leur groupe.

Le design des cheveux crépus fait partie des éléments en faveur de la représentativité des personnes afrodescendantes (Marvel)
“Un noir, il écoute de la musique noire” et on va produire des sortes de stéréotypes généralisants et essentialisants. Ça, c’est une réalité, et il faut des mots pour la décrire. La catégorie qui est utilisée par le discours raciste, c’est la catégorie des races. Donc si on veut étudier le racisme, il faut bien parler de ces catégories de races telles qu’elles sont produites, construites et utilisées pour construire les discours racistes. Donc il faut bien parler de races.
C’est pour ça que le terme de racisé est intéressant même s’il pose d’autres problèmes : ça désigne des personnes qui subissent des définitions qui relèvent des catégorisations raciales. Alors même qu’on sait bien qu’il y a une espèce humaine et que ces catégories raciales sont des constructions historiques, culturelles et politiques.
Comment, historiquement, se sont construites les logiques colonialistes, donc éminemment racistes, dans le jeu vidéo ?
Pour commencer à te répondre, je vais finir de répondre à ta question précédente, sur la question de la race à quoi ça sert dans le jeu vidéo. Les deux sont liés.
On voit bien que lorsqu’il s’agit de construire des représentations dans le jeu vidéo, on va s’apercevoir qu’on va réutiliser des stéréotypes et des catégories qui existent par ailleurs. Si on prend les catégories de l’heroic fantasy, il y a une répartition des habitants d’un univers donné en catégories raciales, et chaque catégorie de race possède des caractéristiques spécifiques. Ça vient notamment du jeu de rôle sur table : telle race ne peut pas utiliser telle arme etc.
Il y a cette idée de catégorisation qu’on va voir implémentée dans les jeux vidéo de façon très fluide. On va s’apercevoir néanmoins dans ces jeux que c’est souvent à la race humaine qu’on offre le plus de possibilités. On a l’impression d’une diversité des races à l’intérieur des univers d’heroic fantasy, mais il y a des interdictions raciales. Par contre, les humains ont la possibilité d’être magiciens, guerriers etc. La plupart du temps, toutes les compétences leurs sont ouvertes.
Ça, c’est un exemple de la façon dont on va retrouver des hiérarchisations raciales dans un truc qui parait tout à fait anodin. Sur les questions de gameplay que tu évoquais, les processus d’exploration, de conquête, c’est pareil. Dans le jeu de rôle sur table, on trouvait déjà ça : couloir, monstre, trésor. Exploration/confrontation/pacification/exploitation des ressources. On retrouve ces mécaniques de gameplay dans le jeu vidéo. Or, ce sont des mécaniques dont on a pu démontrer à quel point elles relevaient de logiques coloniales, dans le sens de logiques élaborées au long des siècles de l’expansion coloniale occidentale à travers des dispositifs économiques, politiques, culturels. Une colonisation tout à fait unique dans l’histoire humaine par son ampleur et la durabilité de ses conséquences.

Assassin’s Creed Valhalla cumule les logiques coloniales exploration/confrontation/pacification de territoires (Ubisoft)
L’histoire proprement dite, c’est plutôt de voir comment le jeu vidéo va réinstaurer quelque chose qui existe en dehors du jeu vidéo. En l’occurrence, c’est logique qu’on retrouve ces dynamiques dans le jeu vidéo. À partir du moment où c’est un type de production culturelle qui s’est développée sous l’influence de l’hégémonie occidentale, il est logique qu’on retrouve ce cadre dominant de représentations produites par cette hégémonie. Les mécaniques de gameplay en sont l’illustration. C’est logique que l’on pense en termes de confrontations, de conquête, de pacification, d’accumulation du capital puisque c’est le contexte qui a vu l’émergence du jeu. C’est pour ça aussi que ça amène à poser la question : est-ce qu’il est possible d’imaginer un jeu vidéo qui échappe à cela ? Est-ce qu’il est possible de créer du fun en dehors de ces logiques ?
Tous les jeux qui visent à déconstruire les rapports de pouvoir sont intéressants parce qu’ils font se poser des questions sur les types de rapport de pouvoir qui existent. Pour faire ce travail, on peut d’ailleurs s’appuyer sur des mécaniques-types exploration/confrontation/appropriation, mais en les problématisant (ce qu’on a dans un jeu comme The Last of Us par exemple). Certains jeux plus expérimentaux font le choix de l’alternative radicale. Mais est-ce que ce sont des jeux auxquels on a envie de jouer tout le temps ? C’est très variable. Il y en a qui vont avoir un certain succès, mais généralement, on voit bien que non. La dimension fun que l’on cherche dans le jeu, j’ai l’impression qu’elle repose énormément sur le fait de pouvoir expérimenter, sous l’angle du jeu, des rapports de pouvoir que l’on vit par ailleurs – y compris lorsque l’on est une minorité.
Dans d’autres pays que les pays occidentaux, on jouait déjà aux jeux vidéo dans les années 70-80, et ça c’est des histoires qui n’ont pas vraiment été écrites.
Alors des fois on sature, et on va jouer à un autre type de jeu. Mais globalement, les jeux qui vont produire les imaginaires collectifs et rassembler les plus grandes communautés, y compris les minorités, ce sont des jeux dans lesquels on va retrouver ces types de rapports de pouvoir.
C’est toute l’ambiguïté du produit culturel : le but n’est pas de produire quelque chose de parfait idéologiquement, mais de produire quelque chose qui permette d’expérimenter de façon éthiquement constructive des types de rapport de pouvoir qui existent dans la société, pour en faire quelque chose qui ne soit pas de l’ordre de la reproduction de la domination, mais quelque chose qui soit de l’ordre de l’expérimentation, de la réflexion, du débat. In fine, c’est par là que passe la voie de l’émancipation.
Pourquoi est-ce qu’il est primordial aujourd’hui d’analyser la production des jeux vidéo sous l’angle postcolonial ? Qu’est-ce que ce courant de pensée apporte comme nouvelles critiques et points de vue sur l’analyse du racisme dans le jeu vidéo ?
Il y a deux choses. C’est vrai que l’approche postcoloniale que je défends à tendance depuis quelques années à être remplacée dans les discours, et les engagements par une approche dite « décoloniale ». Ce n’est pas fondamentalement différent, mais il y a quand même des différences. On peut aussi se poser la question d’une “mode” décoloniale qui finit par s’appliquer un peu n’importe comment, à n’importe quelle initiative un peu décentrée, de façon parfois très peu politique alors même que c’est une perspective très politique au départ.
Pour résumer, disons que l’approche postcoloniale s’est beaucoup développée à partir de l’étude des représentations. Parce que ça vient des études littéraires, comme on peut le voir avec les représentant-es du courant (Edward Said, Homi Bhabha, Shohat…). Les textes canoniques de l’approche décoloniale accordent moins de centralité à la culture, d’ailleurs ça se sent dans les mobilisations décoloniales actuelles, où trop souvent la culture est présente mais après le reste ou pour agrémenter un événement d’un spectacle ou d’une performance. Une importance plus grande est accordée aux rapport sociaux et économiques. Les filiations intellectuelles sont entrecroisées tout en étant un peu différentes, avec des auteurices comme Mignolo, Walsh, Grosfoguel, Dussel.
Les deux ne se contredisent pas nécessairement, même si l’approche décoloniale privilégiée aujourd’hui a reproché à certaines dérives postcoloniales d’être trop abstraites, intellectuelles, et de ne plus se préoccuper des rapports socio-économiques.
Mais si on le veut bien, les deux se complètent et s’articulent.
Je pense que c’est important à divers titres. D’abord, parce que pendant longtemps dans l’histoire du jeu vidéo, le modèle qui a dominé, c’est le modèle du joueur masculin blanc adolescent qui représentait l’archétype du gamer. Alors même que finalement, je ne suis pas certain que ce modèle aurait aussi bien tenu si on avait fait des enquêtes.
Dans d’autres pays que les pays occidentaux, on jouait déjà aux jeux vidéo dans les années 70-80 et ça c’est des histoires qui n’ont pas vraiment été écrites. C’est pour ça que j’avais bien aimé l’enquête de William Audureau sur les jeux vidéo en Union Soviétique : parce que ça permettait de dire que le jeu vidéo était une culture globale avant même qu’on parle de globalisation.
Cette image du joueur de jeu vidéo occidental, c’était une construction sociale et idéologique. Dans les années 80, les minorités (de genre, ethno-raciales, sexuelles) ont commencé à manifester dans les sociétés occidentales en disant : “On veut de la représentation politique et culturelle, on existe !”
Il y a tout un tas de revendications qui sont apparues. Ça s’est traduit au cinéma, aux Etats-Unis par Spike Lee, et en France par le mouvement du « cinéma beur » comme on disait à l’époque. Dans le jeu vidéo, ça ne s’est pas vraiment traduit, en tout cas en France.
Rétrospectivement, on a redécouvert qu’il y avait eu quelque chose avec Muriel Tramis, mais ce n’est qu’aujourd’hui qu’on en reparle ! Pendant longtemps, ça n’a pas été un sujet. Au fil de toutes ces années, c’est un public qui est resté invisible, alors même qu’il a continué à se développer, à être actif, y compris et jusque dans les sociétés de production de jeux.
Dans les années 2000, l’enjeu de la visibilité s’est imposé. Ce n’était plus supportable d’exister en tant que joueur·euse de jeu vidéo et de n’être ni vu, ni audible. Le modèle du joueur de jeu vidéo restait masculin, blanc, occidentalo-centré.
Les réseaux sociaux ont aidé à rendre visible d’autres publics qui ont acquis une capacité à se faire entendre. Forcément, ça entraîne des réactions en termes de production, en termes d’évolutions des récits et en termes de communautés de jeu. Il n’y a qu’à voir le dynamisme incroyable des queer game studies par exemple.
Parce que ça devient possible de créer des groupes par delà les frontières de pays ou de villes. Les approches postcoloniales et décoloniales vont permettre à la fois d’encourager tous ces mouvements de minorité, mais elles vont aussi réfléchir aux conditions qui sont faites à ces minorités pour trouver leurs modes et espaces d’expression, et à quelles conditions ça se fait, quelles sont les perspectives… Évidemment, les questions de genre et de classe sont indissociables de tout cela, même si j’insiste sur la question ethnoraciale car en France on s’y intéresse relativement peu.
L’approche postcoloniale que je défends accompagne les revendications d’un certain nombre de groupes sociaux, et vise aussi à construire des outils pour modifier les représentations et les rapports de force sociaux, de manière plus égalitaire et moins discriminante. C’est un programme vraiment très large, et qui va devoir faire de l’archéologie de l’histoire du jeu et s’intéresser à la façon dont on a construit l’histoire du jeu pour essayer de proposer d’autres perspectives. Le gros de l’activité vidéoludique c’est les pays occidentaux. Le marché africain, au moment où j’écrivais mon bouquin, c’était 1% du marché mondial. Mais dans une perspective postcoloniale on va aussi considérer qu’il y a une importance à accorder à ce qui paraît insignifiant.
J’aimerais qu’il y ait des historiens du jeu vidéo qui s’intéressent à l’histoire du jeu vidéo au Maghreb, et qu’ils rendent compte de ce qu’il se passait dans les années 70-80-90. Et qu’on écrive enfin cette histoire-là.
Il y a aussi une critique sous-jacente du capitalisme. Tu opposes le Nord et le Sud Global. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça inclut comme différences des processus de racialisations ?
Sur la question du Sud Global, c’est l’idée qu’il faut sortir de ce paradigme qui a longtemps dominé qui consiste à opposer son centre à sa périphérie. Avec l’idée que tout ce qui est minorité est intrinsèquement lié au pays d’origine. C’est l’éternel débat qui consiste à continuer de parler d’immigrés à des gens qui sont nés et ont grandi en France.
Parler de sud global, c’est tenir compte du fait qu’il existe des africains qui sont nés, vivent et grandissent en France, mais qui pour autant transcendent les frontières parce qu’ils continuent d’avoir des échanges, soit parce qu’ils y vont, soit parce qu’ils sont connectés, avec les pays d’Afrique. On ne peut plus penser le statut du joueur de jeu vidéo par aire nationale, pourtant c’est ce qu’on continue de faire !

(South_Agency via GettyImages)
Quand on a des études sur les profils de joueurs, ce n’est jamais une question. Est-ce que ce joueur est un maghrébin qui retourne tous les étés au Maroc et qui joue avec ses cousins en ligne toute l’année ? Ou est-ce que c’est quelqu’un qui ne joue qu’avec des gens qui sont en France ? Ça n’est pas la même chose. Les circulations transnationales ne sont pas étudiées.
Parler de sud global, c’est rappeler que le sud est aussi au cœur des métropoles occidentales. Mais c’est aussi les circulations au sein des sud. C’est donc tous les types de circulations qui se construisent entre les quartiers populaires et métropoles occidentales et les pays dits « anciennement du tiers monde », mais aussi entre les suds : toutes les circulations qu’il peut y avoir entre des pays africains, certains pays d’Asie et d’Amérique Latine etc. Sara Sadik, en art contemporain, questionne notamment ce rapport entre cultures vidéoludiques et circulations transnationales. Rappelons cette enquête de Florence Aubenas qui a fait prendre conscience à tout un lectorat blanc qu’il y avait plein de jeunes racisés des quartiers populaires qui voyageaient jusqu’en Thaïlande (pour tout un tas de raisons).
Il me semble essentiel aujourd’hui d’étudier le jeu vidéo en prenant en compte toutes ces réalités à travers les activités des publics. La façon dont les publics et les peuples vivent et pratiquent vraiment les choses, là où le discours de la globalisation capitaliste s’impose comme une sorte de modèle abstrait qu’on vient plaquer sur des réalités.
Au sein de cet écosystème capitaliste, il y a toujours eu des formes de résistance, de réappropriation et de détournement, via des publics désargentés ou des minorités qui voulaient construire autre chose. On sait qu’il y a eu historiquement et très rapidement, que ce soit dans le jeu vidéo ou le cinéma, des tentatives de faire autre chose et de s’affranchir du poids du capitalisme : en inventant de nouveaux modèles économiques, des nouvelles façons de produire ou de jouer…
Dans les pays des Suds, il y a tout un tas de créateur·ices qui travaillent à produire des jeux sur d’autres modes que celui du capitalisme. Cette avant-garde expérimentale a toujours existé. La question c’est de savoir si on se place dans la perspective d’une transformation sociale et dans quelle mesure ces jeux-là peuvent avoir une influence sur les rapports de force au sein de l’industrie.
En soi, c’est parfaitement toléré, du moment que ça ne représente rien d’économique, ça ne dérange personne que l’on fasse du modding ; et ils se le réapproprient même d’ailleurs quand ça devient intéressant. Ou qu’on fasse des jeux expérimentaux pour défendre les minorités.
Par contre, là où c’est important, c’est que ça va permettre à certaines communautés, au sein d’un environnement hostile, de créer des espaces de résistance et de pouvoir qui sont aussi consolidants, et qui vont permettre de continuer d’exister dans un environnement où tout est fait pour qu’on n’existe pas.
En quoi le « privilège occidental » est important pour comprendre les rapports de force et les travers possibles de ce qu’on appelle la diversité dans le JV ?
On est dans une société donnée où on sait que le pouvoir, pour faire simple, est détenu par un groupe social donné. Aujourd’hui, en France, sous Macron, ce qui est valorisé, c’est HEC, c’est le business, donc on sait que si on veut être reconnu, avoir du boulot, de l’argent et du pouvoir, il faut parler et être comme ça pour appartenir au groupe dominant.
Quand on vient de groupes sociaux historiquement discriminés, même si tu as fait de super études, tu vas être bloqué. Forcément à un moment donné tu ne cherches pas forcément ce que tu aimes dans la vie mais faire quelque chose qui va te permettre, à toi et ta famille, de sortir d’une certaine précarité. C’est pour ça qu’on va valoriser un certain type de parcours, d’études, et qu’il faut effacer les traits qui rappellent l’origine, de façon à donner des gages et progresser dans ce milieu social là. Même Bourdieu en parle lorsqu’il parle de son accent béarnais. C’est aussi Yves Montand, de son vrai nom Ivo Livi, qui en parlait. Tout le monde se moquait de lui quand il passait à la radio, alors il a travaillé à perdre le plus possible son accent. C’est des gens qui performaient une certaine norme dominante de la masculinité blanche.
Dans le cas de Bourdieu, c’était une question de classe, et dans le cas d’Yves Montand, c’était à la fois une question de classe et de race. Il fallait gommer cette italianité, jusqu’à changer de nom. Et donc performer une sorte de blanchité.
Cette sorte d’hégémonie a pour force de pouvoir absorber un certain nombre de différences, en les ayant politiquement neutralisées, en enlevant ce qui est subversif et dangereux pour l’ordre établi. Cette hégémonie occidentale a pu continuer jusqu’à aujourd’hui à se présenter comme étant particulièrement inclusive ou en tout cas comme donnant une chance à tout le monde.
C’est ce qui fait à la fois sa séduction et en même temps, ce qui fait sa dimension inégalitaire. En réalité, il y a bien une norme dans cette hégémonie qui est que ce qui se rapproche le plus de ce qu’il faut être, eh bien ça reste l’homme hétérosexuel blanc, et d’un certain niveau social en plus.
C’est se rapprocher de cette norme-là qui donne la mesure de l’endroit où on se situe dans la hiérarchie sociale. Performer l’occidentalité, ça peut apparaître comme une trahison à son groupe social mais ça peut aussi apparaître comme une mécanique de survie dans un environnement particulièrement hostile.
Tout à l’heure, je disais que j’avais bénéficié d’un white passing, alors bien sûr je ne suis pas très basané. En arrivant en France, je parlais couramment marocain, j’ai progressivement perdu ma maîtrise de la langue, et au fur et à mesure, mon français s’améliorait, jusqu’à ce que je devienne meilleur en français qu’en marocain. De la même façon, ma connaissance de la littérature et de l’histoire française s’est vite avérée au-dessus de la moyenne des élèves que je fréquentais et j’étais là aussi le meilleur en francité, en quelque sorte. Je pouvais parfaitement performer cela. Mais c’est quelque chose que je me suis approprié dans un contexte donné par nécessité aussi d’exister dans ce contexte-là.
Ce que j’apportais avec moi n’était pas monnayable. Ce que j’apportais avec moi de marocanité ou d’arabité n’était pas monnayable dans le système français. Ça ne me servait à rien, et au contraire, c’est pire, ça m’aurait entravé. Comme j’étais avec ma mère française blanche, performer ça ne posait pas de problème puisque c’était son identité. Je n’étais pas dans une famille où ça serait rentré en conflit avec la façon dont on vit dans la famille.
C’est uniquement quand je rentrais au Maroc pendant les vacances que j’ai vécu ce conflit-là. Et au fur et à mesure que j’avançais dans une direction, je m’éloignais de l’autre. Ca c’était douloureux.
Ce n’est jamais quelque chose de simple, mais c’est toujours quelque chose qui est lié à des rapports de pouvoir. Parce que, à un moment donné, dans la société capitaliste telle qu’elle existe, on met des gens en compétition et on va être porteur de tout un tas d’éléments qui font qu’on va être plus ou moins avantagés et/ ou désavantagés. Quand on a compris ce qu’il fallait apprendre à faire pour progresser, là on commence à performer dans le sens où on va jouer le jeu, parfois jusqu’à finir par y croire et parfois ça devient par finir une partie constitutive de soi. A force d’apprendre à parler d’une certaine façon, on finit par avoir l’impression de parler de cette façon-là naturellement.
Dans le jeu vidéo, bien sûr la question se pose par rapport aux politiques de diversité, c’est tout le rapport qu’il y a entre comment représenter ces réalités-là, le fait qu’il y a des groupes sociaux qui pour exister sont obligés d’adopter les codes du groupe dominant. Et en même temps, si on veut rendre visible ces minorités, il faudrait les représenter telles qu’elles sont. Or, si on les représente telles qu’elles sont dans un jeu vidéo… Par exemple, on va dire on manque de noirs et d’arabes donc on va mettre des noirs et des arabes. Pourquoi on les met ? Pour que les minorités puissent être visibles et puissent être visibles, et nous nous reconnaissons enfin dans ces personnes, là où il n’y avait que des blancs.
On va dire c’est important de faire ça, mais en faisant ça qu’est-ce qu’on fait en même temps ? On est en train de dire aux personnes qui appartiennent à ces minorités, en fait votre seul choix, c’est d’exister à travers ces figures-là. Vous êtes noir, vous devez vous identifier aux personnages noirs dans le jeu vidéo. On l’a mis là pour vous !
Alors que le joueur blanc, il peut jouer un noir, un blanc, un arabe, on ne lui demande pas. La question ne se pose pas pour lui. Il va faire ce qu’on appelle du tourisme identitaire, il va jouer avec les identités. Quand on enquête auprès des personnes racisées qui jouent aux jeux vidéo, elles vont être dans une position contradictoire et dire qu’à la fois c’est important qu’il y ait plus de noirs, d’arabes, d’asiatiques dans le jeu vidéo qui soient visibles, donc aussi des personnes, des histoires, des modes de récit, des univers qui renvoient à des éléments culturels précis. Mais en même temps, les personnes racisées vont te dire quand tu joues, ce qui compte c’est d’abord que je prenne mon pied, que ce soit fun. Donc peut-être que ce n’est pas si important que ça. En définitive, ça dépend des contextes et des moments.
La politique de diversité aujourd’hui, elle ne va pas viser à renverser les rapports de pouvoir, elle vise essentiellement à mettre un peu de couleur comme ci, un peu de couleur comme ça, et ce qui est le plus apprécié, c’est de faire des mélanges. Mais ça signifie qu’on est en train de reconstruire la façon dont la blanchité se pose comme étant le creuset de la diversité. C’est au sein de l’hégémonie blanche qu’il est possible d’avoir de la diversité.
Dès qu’on s’éloigne de cette norme blanche, on retrouve du soi-disant communautarisme. C’est pour ça qu’il y a une réception ambiguë et contradictoire du personnage d’Aloy dans Horizon. Parce que c’est à la fois une jeune femme, avec toutes les qualités du personnage, mais qui s’approprie aussi un certain nombre de codes culturels de différentes cultures tout en étant très blanche. Elle va être un peu l’incarnation dont la blanchité aujourd’hui se conçoit, c’est-à-dire comme une sorte de hub multiculturel.
L’enjeu de l’industrie n’est pas de modifier les rapports de pouvoir, son enjeu est d’élargir le marché
Dans nos sociétés, ça va être la mode du tatouage ethnique jusqu’à la fusion food. Et ça c’est bien, c’est ça qui est valorisé. Ça enferme les minorités dans des positions où puisque la blanchité prend l’hybridité, la diversité, qu’est-ce qu’il leur reste ? Il leur reste leur caractère essentiel. Moi je suis noir, donc je fais des trucs de noirs. Mais qui est ce qui a dit que j’étais noir ou arabe ? Ce n’est pas moi, c’est le système raciste qui assigne les gens à des positions raciales. Et en même temps tu ne peux pas renoncer à ce qui te définit comme noir ou arabe, sinon tu disparais. Tu vois le piège ?
Il y a une véritable stratégie de marketing de la diversité de la part des studios de développement et des éditeurs. Des associations comme Women in Games ou Afrogameuses y participent aussi. Comment est-ce que tu analyses ces rapports de force et ce que ça dit en substance des initiatives féministes et antiracistes qui fonctionnent ?
Je partage ton constat sur des mouvements comme Women in Games ou Afrogameuses qui d’ailleurs est un constat partagé par des activistes queer, gays, lesbiennes, racisées qui vont dire que ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu’on reste dans des dispositifs et des méthodes qui trouvent vite leurs limites, même s’ils constituent certainement des espaces nécessaires et pour Afrogameuses c’est en plus une initiative unique et précurseure.

Afrogameuses lors du Black History Month (Afrogameuses)
Il faut que ce soit intégré à la formation des développeurs et des game designer, ou que ce soit quelque chose qui fasse partie de la formation au long cours. Et pas juste des interventions ponctuelles pour dire “voilà on a mis un petit peu, on a saupoudré etc”
C’est logique de la part de l’industrie : son enjeu n’est pas de modifier les rapports de pouvoir, son enjeu est d’élargir le marché et avec l’opportunité de minorités qui aujourd’hui revendiquent des places, occupent des positions sociales, de dire on va en mettre un peu parce qu’elles rapportent de l’argent, parce qu’elles ont une influence sur certaines parts du marché. Evidemment, ça vient occulter le travail des activistes derrière qui ne se positionnent pas du tout de la même façon sur ces enjeux de diversité.
D’ailleurs, le mot diversité devient problématique, parce qu’on sait plus de quoi on parle.
Il y a un risque de considérer le sujet blanc occidental comme homogène, qui ne prend pas en compte les différentes identités blanches et les principes de domination culturels au sein des peuples européens. Est-ce que ça remet en question les analyses postcoloniales du racisme dans le jeu vidéo ?
Il y a des ouvrages qui ont discuté par exemple de comment les irlandais n’ont longtemps pas été considérés comme des blancs, et comment ils sont devenus blancs. On pourrait faire la même chose avec les polonais et les italiens en France, ou voir la façon dont les corses continuent de se voir apposés des caractères raciaux, qui vont les définir.
Ce qui a été peu étudié, c’est davantage ce rapport quand on parle d’occident, on crée une sorte d’homogénéité du sujet occidental blanc, qui est assez bizarre d’ailleurs, puisque ce sujet peut être noir, arabe, asiatique. D’ailleurs, ce sont des individus qui peuvent expérimenter le fait que s’ils retournent dans le pays de leurs parents, ils vont se rendre compte qu’ils sont perçus comme des occidentaux.
Moi, n’étant pas né en France, j’ai toujours été en décalage avec les enjeux et les préoccupations de certains de mes coreligionnaires maghrébins français nés ici. Étant en plus de double nationalité de naissance, pour moi ça a jamais été un enjeu que d’être français. Français je l’ai été pleinement tout de suite comme j’ai été tout de suite pleinement marocain dans ma tête. Et venant d’un milieu social aisé et urbain mais vivant un déclassement avec l’arrivée en France dans un milieu rural, j’ai pas du tout vécu les choses de la même façon qu’un gamin né dans une banlieue dans une famille pauvre ou modeste.
Il y a une hétérogénéité du sujet occidental qui est souvent occulté. Dans le jeu vidéo, et dans l’approche postcoloniale, il y a eu toute une réflexion sur l’orientalisme par rapport aux pays de l’Est. La façon dont les pays de l’est ont été construit comme un orient de l’europe occidentale. C’était vrai déjà avant la guerre froide, notamment parce que ce sont des territoires qui ont été pendant longtemps sous influence ottomane.
Ce sont des territoires liminaires. Le mythe de Dracula, nous rappelle que ce sont des territoires de l’Orient. Ce qu’on a observé dans le jeu vidéo en provenance de ces pays, c’est une tentative de se raccrocher à cette hégémonie occidentale et en même temps en faisant ça, ils essaient de construire une identité nationale. N’oublions pas que ce sont des pays où les identités nationales ont été bousculées et reconfigurées par le modèle soviétique, qui a cherché à créer un homo sovieticus.
Il y a ce paradoxe dans les productions de jeu vidéo à l’est je trouve, ils sont à la fois raccrochés à une occidentalité et au sujet blanc occidental, et en même temps ils veulent créer une spécificité nationale avec un discours nationaliste sous-jacent, porteur d’une identité spécifique.
L’approche postcoloniale va nous permettre de penser pourquoi il y a ça, parce qu’on va se dire que s’il y a ça, c’est parce qu’il y a un rapport de pouvoir inégalitaire qui se joue entre le centre de cette hégémonie de l’europe occidentale, et ces territoires-là, qui sont dans son orbite mais qui sont dans une situation un peu subalterne.
Comment structurellement on peut changer les choses ? Est-ce que recruter des historiens ou des sociologues dans les studios de développement sont des initiatives qui peuvent changer la donne ?
Je dirais qu’il y a différents niveaux : il y a un niveau politique, c’est-à-dire si en France le pouvoir politique change et qu’il souhaite s’attaquer à ces questions-là, forcément ça va permettre d’engager des politiques publiques d’ampleur qui vont contribuer à changer les choses.
Après si on continue dans les réalités actuelles, avec les fortes inégalités qui subsistent, la question est multifactorielle. Il y a à la fois tout le mouvement indé, tout ce qui va constituer les divers activismes qui peuvent exister et qu’il faut continuer à encourager, y compris lorsque c’est pas dénué d’ambiguïté, de contradictions. Bien sûr, il faut continuer d’accompagner ça. Si c’est des studios qui se donnent pour objectif de produire des jeux différents, et de les produire différemment, eh bien ça va jouer aussi. Mais ça va poser en même temps la question de leur viabilité économique essentiellement, les concessions qu’il faudra faire pour se maintenir. Il ne faut pas se faire d’illusions non plus, ce n’est pas évident.
De mon point de vue, les conditions ne sont pas réunies pour qu’il y ait un mouvement d’ampleur qui permette vraiment de transformer les choses. Par contre, les conditions sont réunies pour que les gens qui ont envie de changer les choses travaillent ensemble.
Les universitaires embauchés dans les studios je ne pense pas que ce soit intéressant. Ils font leur travail, mais je pense pas que ce soit intéressant de se doter de ce système d’expertise. D’abord parce que l’expertise, c’est très pervers comme système, comme les journalistes qui écrivent leurs articles à partir de citations d’expert-es sans enquêter vraiment au fond, parce qu’iels n’ont plus le temps de le faire. Je crois davantage dans le fait de réunir des équipes qui vont concrètement se poser des questions entre elles, qui vont être porteuses d’identités différentes et d’inscriptions sociales différentes. Et qui du coup vont négocier entre elles la possibilité de construire quelque chose en commun. Je crois davantage en ça. Et d’ailleurs ces gens-là lisent aussi des livres d’universitaires, mais vont pouvoir s’en emparer depuis une position qui n’est pas celle de l’expertise.
Cela nécessite de se former à des procédures et des méthodes de travail qui évitent de reproduire les mécanismes de domination des groupes sociaux sur les autres. L’enjeu, il est d’abord là. Parce que ces gens-là existent. Ce n’est pas difficile de trouver des gays, des lesbiennes, des trans, des arabes, des noirs, des asiatiques pour travailler dans le jeu vidéo, pour faire des jeux.
Par contre ce qui est difficile, c’est de créer des conditions qui donnent envie à ces personnes de travailler ensemble pour construire quelque chose en commun. Ce qui est encore plus difficile, c’est que ces conditions permettent de ne pas reproduire la domination d’un groupe sur un autre.
Ca veut dire se poser tout un tas de questions qui vont de l’organisation du travail, au type de sujets ou de thèmes que l’on emploie, aux questions de mécaniques de gameplay, aux questions économiques de comment on produit et on vend, est-ce qu’on vend ou pas…
Ce n’est pas juste la question de la visibilité et de la diversité. Il faut être très concret, c’est comment on travaille.
Moi dans un groupe avec mon capital culturel en étant un homme cisgenre, si je me retrouve dans un certain type de groupe, je peux arriver à reproduire un certain type de mécanisme de domination, y compris à mon corps défendant si je ne suis pas formé à y faire attention, et si les autres ne sont pas formés à m’alerter là-dessus ou n’ont pas le pouvoir et les moyens pour m’en empêcher.
J’essaie d’être peu présent dans les médias et je réponds très peu aux sollicitations parce que j’ai la volonté de ne pas apparaître comme l’expert d’un sujet qui en réalité peut être porté par beaucoup de monde, et avec des points de vue très riches, très différents.
Par contre, le livre avait pour objectif de participer à créer des espaces pour d’autres. Il y a des pistes de réflexion sur lesquelles on peut travailler, c’est une invitation à d’autres pour occuper ces espaces.
Il faut questionner aussi les lieux de formation aux métiers du jeu vidéo, comment on sélectionne, quels types d’enseignements on donne, on apprend à faire quoi.
Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur la thématique du racisme dans le jeu vidéo ?
Déjà te remercier pour ton travail et ton initiative. Peut-être dire qu’il ne s ‘agit pas d’une entreprise idéologique qui vise à purifier les esprits et les représentations mais davantage à former des discours, des lieux de débats et d’échange par rapport à toute la complexité et la contradiction qu’on peut expérimenter quand on est confronté au monde social. Oui on peut aimer les jeux de guerre et dégommer des zombies parce qu’on trouve ça fun, tout en étant un absolu pacifiste et non violent par ailleurs. C’est important de le rappeler.
Quand on travaille de façon critique sur tous ces enjeux là, ce n’est pas une opération de purification qui est en jeu, c’est une opération de transformation sociale et elle ne veut pas dire nier la complexité et les contradictions quand on a affaire à des productions culturelles.
Ce qu’on observe aujourd’hui, c’est qu’il y a dans le secteur du jeu vidéo une sorte d’alignement entre un certain nombre de représentations et un certain nombre de réalités matérielles et sociales. Forcément on se dit que changer les représentations ça peut contribuer à modifier les rapports sociaux. Ce qui n’est pas faux mais pas vrai non plus, ça ne suffira jamais. Ce n’est pas parce qu’on va modifier les discours et les représentations que ça va modifier les rapports sociaux. Ca va contribuer à créer des espaces où on va pouvoir exister en tant que sujet, se reconnaître dans des choses, mais ça ne va pas transformer les rapports sociaux. C’est le type de pouvoir concret qui va émerger de ces espaces qui pourra transformer les rapports sociaux.
Le racisme dans le jeu vidéo s’insère dans un système oppressif multifactoriel, dont le racisme n’est qu’une des variantes, avec le sexisme, le validisme, les LGBTphobies et tant d’autres.
Les analystes féministes et antiracistes ont d’ailleurs prouvé à quel point ces différentes oppressions peuvent s’entremêler, comment elles peuvent entrer en intersection. Etre une femme noire, c’est s’exposer d’une part au sexisme (vécu en tant que femme) et d’autre part au racisme (vécu en tant que personne identifiée comme noire), qu’on appelle plus communément la misogynoir.
Depuis plusieurs années, les studios de développement et les éditeurs de jeux vidéo ont mis en place des politiques internes de diversité. Des initiatives loin d’être des cas de philanthropie, puisqu’elles ont unanimement été prises en réaction aux polémiques et aux violences sexistes et racistes. Généralement d’ailleurs, c’est surtout les violences sexistes et sexuelles qui ont fait parler d’elles, loin devant les violences racistes.
Ce n’est d’ailleurs pas incongru que les initiatives féministes soient majoritaires par rapport aux initiatives antiracistes dans le jeu vidéo.
Pour les éditeurs et les studios de développement, il s’agit de conserver une image positive auprès de sa fanbase (et ses potentiels acheteurs et partenaires). Le marketing de la diversité réside, comme le disait très justement Mehdi Derfoufi, dans cette capacité à vouloir élargir le marché et son potentiel, tout en donnant quelques billes aux féministes et antiracistes, mais jamais sans renverser les rapports de pouvoir.
C’est notamment pour ces raisons que des liens et des partenariats sont tissés entre les associations de défense des droits des femmes et des minorités. Les éditeurs trouvent un intérêt non négligeable à les mettre en valeur, que cela passe par des formations, des ateliers coaching, des invitations aux Pégases…
Pour autant, ces initiatives ont le mérite d’exister et de permettre à des personnes de l’industrie de s’éduquer, de prendre conscience des régimes oppressifs. Parce que ne rien faire, ne pas s’opposer, même de manière non radicale, justifie de faire le jeu du pouvoir. Accepter de jouer avec les règles du jeu a ce mérite de faire exister des initiatives qui peineraient à exister symboliquement autrement. Mais que cela ne fasse pas oublier que ce ne sont jamais les personnes marginalisées qui les dictent.
Mehdi l’expliquait en fin d’entretien : « Ce n’est pas parce qu’on va modifier les discours et les représentations que ça va modifier les rapports sociaux. Ca va contribuer à créer des espaces où on va pouvoir exister en tant que sujet, se reconnaître dans des choses, mais ça ne va pas transformer les rapports sociaux. C’est le type de pouvoir concret qui va émerger de ces espaces qui pourra transformer les rapports sociaux«
Les luttes contre le racisme dans le jeu vidéo ne peuvent se satisfaire de petits pas, et ce ne sont pas les initiatives libérales des éditeurs et studios de développement qui changeront significativement la donne. Sans remettre en cause le bien-fondé des personnes en charge de la diversité dans les studios, qui croient certainement bien faire, le secteur jeu vidéo a besoin de radicalité.
Les nouveaux espaces d’empowerment, souvent en non-mixité choisie, sont les plus à même d’être porteurs de ces radicalités. Elles participent à l’émergence de nouveaux rapports sociaux, et offrent des perspectives qui vont construire de nouveaux rapport de forces, cette fois en faveur des minorités. Décorrélé de l’influence des patrons et des grands groupes du jeu vidéo, l’avenir de l’antiracisme se joue dans ces nouvelles organisations militantes.
perspectives qui vont construire de nouveaux rapport de forces, cette fois en faveur des minorités. Décorrélé de l’influence des patrons et des grands groupes du jeu vidéo, l’avenir de l’antiracisme se joue dans ces nouvelles organisations militantes.